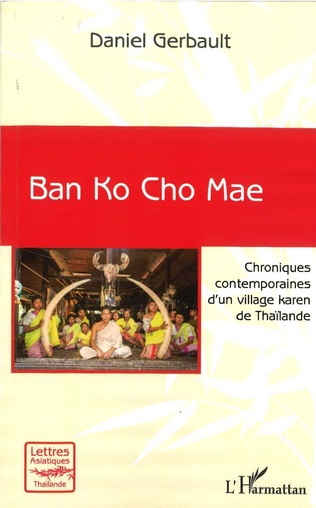Chapitre trois
Ce premier voyage remonte à 2001. Enchanté par tout ce que j’y ai vécu. Par les rencontres, par le culte qui y est pratiqué, par la découverte de ce mode de vie, je n’imaginais pas que ce serait le début d’une longue histoire entre le village et moi. De nombreux évènements allaient s’y produire sur deux décennies. Quelques mois plus tard, je décide de retourner au village à la recherche de Pawa. Cette fois, je connais le chemin et je pars donc seul. Je vais loger chez Maw A Mee. J’ai bien aimé sa franchise et son humour. J’arrive la veille de la pleine lune.
Le lendemain, je me rends au temple. Les jours de la pleine lune sont auspicieux, car consacrés au culte. Comme chez les bouddhistes, le cycle des lunaisons rythme le calendrier religieux. Le sanctuaire est établi à l’écart du village dans une cocoteraie clairsemée. Un panneau à l’extérieur énumère toutes les règles de vie à observer par les adeptes du culte. Dans un petit bâtiment en bois près du portique d’entrée sont accrochés les harnais en fibre végétale des deux éléphants appartenant au temple. Un passage cimenté couvert mène à un préau où sont rassemblés les fidèles. Je m’y engage. Au milieu d’un vaste espace dégagé se trouve un large pavillon en bois. Il abrite deux paires de défenses d’éléphant sacrées de tailles différentes. Les plus longues se font face ; leurs pointes presque accolées l’une à l’autre forment un arc-en-ciel, séparé en son milieu. Elles sont finement gravées à l’effigie de Bouddha sur toute leur longueur. J’apprendrai plus tard leur origine légendaire. Sous les défenses trône une statue ancienne du Bienheureux ; impassible, il médite sur une fleur de lotus, en posture Bhumiparsa — prise de la terre à témoin. En contrebas, la statue d’un ermite barbu. Sur le fronton des gongs triangulaires de Birmanie en bronze se balancent au bout d’une ficelle. Devant le pavillon un panneau en bois écrit en karen et en thaï avertit : « au-delà de cette limite, les femmes ne sont pas autorisées. » Le monde indien n’est pas loin. La femme menstruée est considérée source de souillure par les hommes.
Je me dirige vers l’assemblée des fidèles quand quelqu’un me fait signe. C’est Pawa. Nos visages s’illuminent instantanément. Je me fraie un passage parmi la foule compacte. Il m’invite à m’asseoir par terre près de lui.
— Quand es-tu arrivé ? Chez qui loges-tu ?
— Hier. Chez le poo yaï ban cette fois, lui répondis-je.
Pawa se tourne vers ses voisins et se met à raconter avec force gestes les circonstances de notre rencontre. Ne parlant pas le karen, j’en suis réduit à observer les visages. L’auditoire, jusque-là impassible, est suspendu aux lèvres de Pawa révélant ses talents de conteur hors pair. Certains me prennent affectueusement la main, un homme m’offre à boire.
— Viens dîner chez moi ce soir, me propose-t-il spontanément.
Cette bienveillance pour autrui, je la constaterai à maintes reprises chez les Karens.
— Les farang sont des membres de notre famille. Nous avons vécu si longtemps séparés les uns des autres. Aujourd’hui, nous fêtons nos retrouvailles, me dit-il portant sur moi un regard de père à son fils.
Je suis touché par ces paroles que l’on entend trop rarement dans la vie. Elles me laissent songeur. Après tout, nous, les êtres humains, descendants des australopithèques, sommes issus du même berceau africain. Notre ancêtre commun Toumaï, d’après les anthropologues, a sept millions d’années ou serait-ce Lucy ? La conception des relations humaines de Pawa résonne comme une leçon de vie. Je pense à la chanson du regretté John Lennon « imagine all the people… »
Pawa explique aux gens qui nous entourent les circonstances de notre rencontre. Il m’apprend qu’il a été disciple du Pu Chaik pendant une dizaine d’années. Nous nous avançons vers le saint des saints, le cœur de l’ashram, une longue maison en bois sur pilotis dominant le préau. Monnae, tout proche, surplombe l’assemblée des fidèles, assis en tailleur. À son pied, un amoncellement bigarré d’offrandes : de la canne à sucre, des grappes de noix d’arec, des ananas, des sacs de riz.
Nous nous prosternons trois fois. Monnae la cinquantaine, est drapé d’une tunique blanc écru qui dévoile son épaule droite. Son regard est âpre, presque insoutenable. Ses longs cheveux noirs sont rabattus en chignon au milieu de son front à peine ridé. Sa figure carrée et anguleuse accentue sa rigidité apparente. Il est chaussé de grosses lunettes rondes lui donnant un air important. Sa bouche fermée s’ouvre de temps en temps pour mastiquer sa chique de bétel. Il porte autour du cou un chapelet de cent huit perles en bois de santal et aux poignets, des fils de coton de protection. De jeunes adolescents au visage androgyne, des servants de pagode, dirait-on chez les bouddhistes, sont assis à ses côtés le regard vide. Au haut du fronton, un crâne de buffle, aux larges cornes, domine l’assemblée.
Un étranger qui vient deux fois chez eux. Serais-je un missionnaire venu convertir ses fidèles ? Pawa sert d’interprète au Pu Chaik, qui ne parle pas le thaï. De culture karen, né en Birmanie, il peut s’exprimer aussi en birman. Il est astreint à demeurer en permanence au temple. Je le rassure, par l’intermédiaire de Pawa, de mes intentions : simple voyageur, curieux de nature, je souhaite simplement découvrir les mœurs de ce village si fascinant et sans doute unique en Thaïlande. Pu Chaik se déride. Le doute et la suspicion dissipés, son visage s’éclaire. Pawa m’est d’une aide précieuse. Il a toute la confiance de son maître spirituel. Monnae, soudain de bonne humeur, engage même la conversation avec moi.
— Dans votre pays, combien y a-t-il d’ethnies ? Veut-il savoir.
Question difficile. Une ethnie, c’est un ensemble de personnes qui partagent la même culture, la même langue, les mêmes traditions, transmises de génération en génération. On parle du peuple corse ou basque, mais pas d’ethnie corse ou basque. Question de vocabulaire. Depuis la révolution jacobine, la France métropolitaine ne reconnaît qu’un seul peuple et les statistiques ethniques n’y sont pas autorisées (en revanche, elles le sont en Nouvelle-Calédonie). Dans l’état civil français, l’origine ethnique n’est pas indiquée et n’a pas d’existence juridique. Je réfléchis à la réponse à donner.
— Une dizaine, avançai-je. (Les Basques, les Corses, les Bretons, les Alsaciens, les Ch’tis, etc.) Mais la plupart sont acculturées parce qu’autrefois, on interdisait aux enfants de parler leur langue régionale à l’école. On les forçait à parler français. Même les sourds, depuis le congrès de Milan en 1880, n’avaient pas le droit de s’exprimer en langue des signes à l’école[1]. Quand je dis une dizaine, il faudrait ajouter les ethnies des DOM-TOM, les Kanaks, les Amérindiens de Guyane. Je me dis en mon for intérieur que peu de Bretons parlent le breton, que la coiffe bretonne est devenue folklorique et que la République a phagocyté les identités des peuples.
— Et quelle est l’ethnie qui est arrivée la première sur terre ? Veux encore savoir Monnae.
— Selon les chrétiens, c’est Adam et Eve, mais on ne sait pas à quelle ethnie ils appartenaient. Ils sont représentés sous les traits d’Occidentaux ; ils ne sont donc ni africains ni asiatiques. Selon les paléontologues, l’ancêtre de l’Homme est africain. On a retrouvé des ossements. C’est tout ce que je sais. Et selon vous, quelle est l’ethnie qui est arrivée la première sur terre ?
— Les Karen (ce sont les aînés.), ensuite les Birmans, puis les Môn, puis les Thaïs et en dernier les farang dans cet ordre. Ce sont les farang qui possèdent le Livre d’or et l’écriture me répond assurément Monnae.
L’échange que nous venons d’avoir en dit beaucoup sur leur cosmogonie. J’ai eu l’impression que Monnae me tendait un miroir me renvoyant l’image de ma propre civilisation en me posant des questions inattendues et déroutantes. Poussé par la curiosité, je découvrirai, par la suite, les travaux d’ethnologues spécialistes des Karen comme Théodore Stern et Abigaël Pesses.
« Le plus illustre des mythes karens relate, dans le Livre d’Or, la création du monde par le démiurge Zwa ; ses versions sont postérieures à la colonisation britannique du XIXe siècle. Il établit qu’au moment de la création des différents groupes tribaux, il y avait trois frères : un Karen aîné, un Birman et un jeune frère blanc. Zwa, après avoir créé l’être humain et avant de se retirer de la création, met de côté un Livre d’Or pour le Karen. Mais ce dernier, occupé à défricher, omit de le récupérer. Zwa confia alors le Livre de la connaissance au plus jeune frère blanc qui vient le prendre à sa place. Selon certaines versions, le cadet construit en remerciement un bateau pour Zwa et le transporte avec le Livre au-delà des océans, d’où Zwa fait son ascension au Paradis. Ce mythe, aux connotations millénaristes, entretient l’espoir du retour de Zwa et du “jeune frère blanc” qui ramènera le Livre d’Or. Il va servir, a posteriori, de justification à l’évangélisation et au mouvement de libération politique karen.
Selon une autre version, Zwa, avant son départ, convoque tous ses fils pour leur transmettre sa sagesse et sa connaissance. Chacun reçoit alors un Livre du Dieu qui les a créés. Le Karen, en tant qu’aîné, est le principal dépositaire de cette connaissance. Il reçoit un Livre d’Or et s’en retourne avec à ses tâches agricoles. Mais trop absorbé par ses travaux, il l’oublie par inadvertance sur la souche d’un arbre et le brûle avec son essart. Dès lors, des poules viennent gratter et picorer la cendre du Livre. Les Karen expliquent ainsi que, n’ayant plus directement accès au Livre d’Or, ils consultent les os de poulet (sauf à Ban Ko Cho Mae où l’élevage en est interdit) comme support de divination. Cette version du mythe, qui relate la perte de l’écriture et justifie l’origine des pratiques animistes karen, explique en contrepartie leurs lacunes technologiques et la dépossession de leur statut d’aînesse vis-à-vis de leurs frères cadets, quant à eux dotés d’un livre propre. Le mythe du Livre d’Or n’est cependant pas spécifique aux Karen. En effet, la perte de l’écriture représente un thème récurrent parmi de nombreux autres groupes montagnards, notamment les Hmongs, les Akhas, les Lahu et les Lisu. Elle explique autant leurs décalages sociaux, technologiques et politiques vis-à-vis des populations des plaines que leur position subordonnée à ces oppresseurs plus puissants ». (Pesses, 2004 : 190-192).
Soudain, des novices se lèvent à la suite de leur maître en direction de l’autel qui abrite les défenses d’éléphant. Pu Chaik commence ses dévotions. Il allume trois bougies qu’il dépose successivement, accompagnées de trois fleurs, devant la statue du Bouddha, l’effigie de l’ermite, et les deux paires d’éléphants. Après chaque dévotion, il frappe d’un coup sec la base des petits gongs triangulaires avec une mailloche. L’onde cristalline, rappelant celle des bols tibétains, se propage par vague ample et longue, suspendue dans l’air avant de s’estomper en douceur. Les fidèles poussent des clameurs brèves.
[1] « En 1880, charité chrétienne et science se sont liguées pour interdire leur langue aux sourds. L’ombre de ce crime s’étend sur la majeure partie du siècle suivant » Moi, Armand, né sourd et muet. Armand Pelletier, Yves Delaporte 2002.